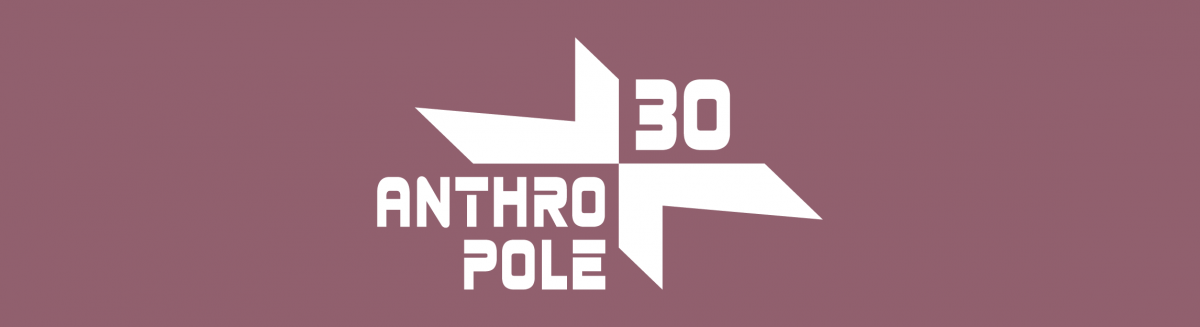Photo: © Alain Kilar
Les moulages grecs
En plus des répliques égyptiennes, l’Anthropole compte encore d’autres moulages en plâtre: deux statues grecques et une stèle d’Erétrie. Sur l’exemple de l’acquisition en 1976 des autres moulages, les statues grecques ont été héritées à la suite de la 70e édition du Comptoir suisse en 1989, lorsque la Grèce est pour la seconde fois hôte d’honneur de l’événement. Quant à la stèle, l’originale a été découverte en Erétrie par l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce, dont le siège est à l’UNIL. Le moulage a été exposé d’abord à Athènes, puis en 2010, à la Skulpturhalle de Bâle, avant de terminer son périple à l’UNIL en 2011.
Le fait qu’une université détienne des moulages et les expose n’est pas surprenant – le fait qu’ils aient été majoritairement acquis via le Comptoir suisse par contre, est assez original -. Dans le courant du XIXe et XXe siècle, en Allemagne d’abord et en France ensuite, une majorité d’universités crée leur collection de moulages dans un but pédagogique en archéologie, en histoire et en histoire de l’art. Bien sûr, les moulages sont déjà utilisés depuis des siècles dans les écoles des Beaux-Arts, ils diffusent les canons esthétiques des différentes époques – particulièrement grecques -, transmettent des connaissances en matière d’archéologie. Le plâtre permet de façon durable et fidèle de représenter n’importe quel volume, ces moulages sont donc des documents précieux. La statue de l’homme grec de l’Anthropole est un bon exemple de cette tradition de la représentation d’un corps masculin, héritée de l’Antiquité et véhiculée par des reproductions.
Statues grecques et stèle d’Erétrie: un aperçu des collections de moulages
Le statut de ces moulages a été largement débattu. D’un côté, on ne percevait dans ces répliques en plâtre qu’une étape, l’objet en lui-même n’était pas considéré comme une œuvre, tandis que de l’autre, on voyait dans la possession de la copie le même prestige que la conservation de l’original. Aujourd’hui, le moulage gagne en autonomie et on trouve, en dehors des universités, des musées spécialisés par le sujet, comme à Bâle. La terminologie utilisée pour les définir est aussi vaste que leur contenu : musée de moulages, musée de Sculpture comparée, galerie des études, cabinet des copies ou encore gypsothèque.
La réalisation de ces reproductions requière une grande compétence, elle est assurée par des ateliers où travaillent des artisans mouleurs-statuaires. Ces spécialistes doivent faire preuve d’un grand savoir-faire lors de toutes les étapes d’élaboration de la copie : la manutention de l’œuvre originale, sa protection par un produit adapté à sa matière, la relève d’empreintes, la réalisation de moules (plusieurs moules assemblés pour répliquer une sculpture), le moulage et le démoulage.
Leurs techniques évoluent au fil du temps, la plus répandue était d’abord celle des moules en terre – qui nécessitaient ensuite un grand travail de reprise sur le moulage pour le nettoyer des résidus – puis celle en gélatine, en silicone (utilisation répandue aujourd’hui), et dernièrement, la prise d’empreintes numériques. L’atelier collabore ensuite avec des experts en patine qui travaillent à donner au plâtre l’aspect d’une matière différente comme le bronze, le marbre ou la terre cuite.
L’UNIL possède, certes, un nombre minime de moulages (certaines universités en comptent des milliers), acquis dans un but décoratif – et non pas lié à une intention pédagogique comme c’était le cas dans les universités un siècle auparavant – mais, déjà avec une quinzaine de reproductions exposées dans l’Anthropole, nous pouvons comprendre l’intérêt de ces objets qui permettent la diffusion, le rapprochement, et la confrontation de pièces séparées à l’origine par de nombreux siècles.
Lorena Ehrbar, assistante-étudiante en archives