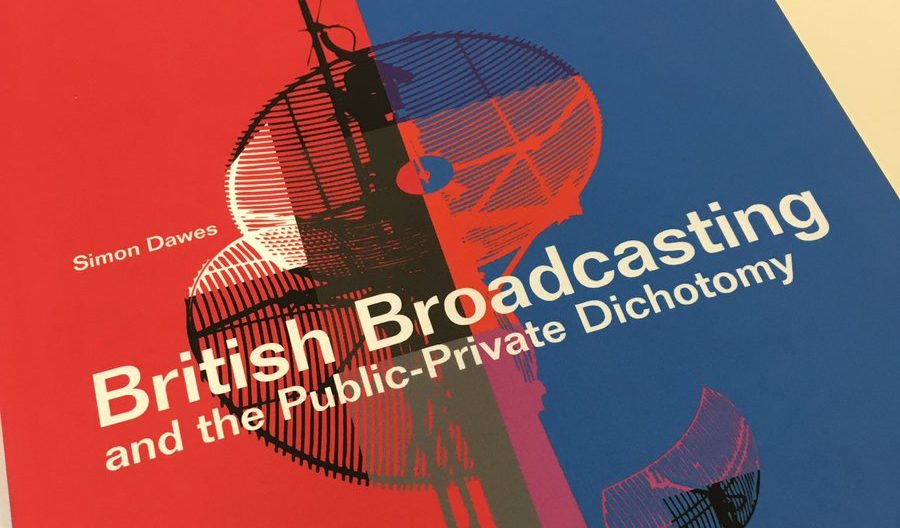Simon Dawes sur la notion de service public
Profitant d’un séjour prolongé à Londres, nous entamons une série consacrée à l’évolution des Television studies et du service public audiovisuel en Grande-Bretagne. Nous commençons celle-ci par un entretien avec Simon Dawes qui vient de publier sa thèse (British Broadcasting and the Public-Private Dichotomy. Neoliberalism, Citizenship and the Public Sphere, Palgrave, McMillan, 2017) consacrée à l’évolution de la régulation audiovisuelle en Grande-Bretagne.
Par François Vallotton, novembre 2018.
Simon Dawes est Maître de conférence à l’Institut d’études culturelles et internationales (IECI) et chercheur associé au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC) de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) en France. Il participe également à la réflexion menée au sein du collectif, The Media Reform Coalition, qui réunit des représentants du monde universitaire, du monde médiatique et de la société civile pour réfléchir aux questions contemporaines de gouvernance médiatique. La thèse de Simon Dawes est l’opportunité de remettre cette problématique dans une perspective historique, tout en invitant à des comparaisons – qu’il reste à prolonger – sur la nature et l’évolution du service public en Suisse et en Europe.
Simon Dawes a répondu à nos questions par voie électronique. Nous le remercions très chaleureusement pour sa contribution.
François Vallotton: Tu insistes dans ton ouvrage sur la nécessité de repenser les catégories de public et de privé en rompant d’une part avec la dichotomie qui prévaut dans la littérature secondaire (le modèle américain versus le modèle européen) et en privilégiant d’autre part une perspective historique montrant comment cette interaction s’est constamment renégociée au fil du temps. Pourquoi cette prémisse et quelle conséquence sur la définition même de la notion de service public ?
Simon Dawes: La raison d’être de l’historicisation de la dichotomie public-privé était à la fois théorique, méthodologique et politique. Cette dichotomie a d’abord été identifiée comme une opposition importante, à la fois dans les documents réglementaires et politiques sur la radiodiffusion britannique et dans la littérature secondaire, dans le champ des études sur les médias et les communications au Royaume-Uni ainsi que dans la littérature anglophone en général. Du fait d’une certaine doxa liée à l’idée de service public, un engagement interdisciplinaire privilégiant une approche historique et étroitement reliée à certains concepts connexes (citoyenneté et consommation, sphère publique, néolibéralisme) est devenu nécessaire. Après tout, le travail de Habermas sur la sphère publique (si souvent cité en référence par les spécialistes de la radiodiffusion) est lui-même une historicisation de cette dichotomie à partir du développement de la liberté de la presse et de l’opinion publique, ainsi qu’une relecture critique de ces concepts dans les perspectives libérale, républicaine et marxiste.
En matière de radiodiffusion, le problème de l’application d’une dichotomie trop rigide (la radiotélévision de service public est bonne, la radiotélévision commerciale est mauvaise) est qu’elle tend à ignorer les aspects positifs des modèles commerciaux (que ce soit dans une économie réglementée de service public ou non) et les aspects négatifs des radiotélévisions de service public. Revenons sur ce dernier point : Il ne s’agit pas seulement de savoir dans quelle mesure, par exemple, le service des informations de la BBC a parfois échoué, dans sa pratique, à répondre aux normes d’impartialité qu’on attend d’elle, ou de critiquer le fait que les divertissements de la BBC n’ont pas toujours une plus-value à offrir en termes de qualité. Il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure le service public a été véritablement «public», et d’examiner ce que cela signifie exactement. Souvent, cela signifie qu’il est indépendant (à la fois des intérêts du gouvernement et des intérêts de l’entreprise). Mais l’indépendance de la BBC est un enjeu de débats et de luttes permanent, et elle a récemment été rendue moins indépendante du politique, les membres du gouvernement ayant désormais un rôle dans la gestion quotidienne de l’organisation. En ce qui concerne ce dernier point, nous pourrions également nous référer aux interactions étroites qui existent entre les professions de la BBC d’une part, et des cadres du Parti conservateur et de l’establishment plus large de Westminster de l’autre. Ou encore à la montée de la culture de l’évaluation et des logiques néolibérales de concurrence et d’entrepreneuriat au sein de la BBC depuis les années 1990 (comme nous le démontre Georgina Born, 2005, et Tom Mills, 2016), malgré son caractère apparemment «public». L’indépendance concerne également celle de l’organisme de régulation de la BBC, qui a historiquement été toujours trop proche de la BBC elle-même et du gouvernement ; un radiodiffuseur public véritablement indépendant devrait donc être indépendant des influences de l’État comme du marché et responsable auprès d’un organisme de régulation lui aussi tout aussi indépendant.
Mais il s’agit aussi de savoir dans quelle mesure ce radiodiffuseur a déjà été une entreprise «publique», c’est-à-dire que le public lui-même a son mot à dire dans la façon dont elle est gérée. La notion (de plus en plus critiquée) de «service public» porte avec elle des références remontant au XIXe siècle et une certaine condescendance élitiste victorienne envers les masses. Il a peut-être été conçu «pour le public», et en ce sens il a recouvert beaucoup de choses positives, mais il n’a jamais été géré «par le public». Il s’agit d’une structure hiérarchique, fondamentalement «top-down», qui crée une citoyenneté aussi passive que les consommateurs, décrits longtemps comme «aliénés», de l’industrie culturelle. C’est un vœu pieux et naïf que de penser que le seul recours au terme de «citoyens» suffit à assurer la participation active du public.
De même, nous devons être prudents quant au recours stratégique à des notions de «public» qui relèvent du sens commun. Je sais bien que, si vous vivez dans un pays où les médias nationaux sont les relais de la propagande d’Etat, des concepts tels que «liberté de la presse» et «intérêt public» sont évidemment des valeurs importantes et essentielles à promouvoir. Mais l’exemple de l’histoire des médias britanniques montre que la liberté de la presse peut facilement être confondue avec le libre marché et/ou (ce n’est pas la même chose!) le pouvoir illimité des barons de la presse ; d’un autre côté, le terme d’«intérêt public» a été mobilisé dans les politiques successives de l’audiovisuel, et cela dès les années 1960, pour substituer au monopole du «service public» un équilibre entre les valeurs du service public et de la concurrence. Avec les dispositifs de régulation les plus récents, nous devons maintenant également composer avec la notion de «valeur publique», ce qui, une fois de plus, semble très séduisant, mais qui, à y regarder de plus près, ne fait que nous éloigner encore plus du «service public» : le terme, relevant du New Public Management, renvoie en effet à une approche qui essaie de rendre poreuse les frontières entre les organismes publics et privés.
FV: Ton cadre d’analyse est beaucoup influencé par une perspective foucaldienne et notamment sa réflexion sur le néolibéralisme présente dans ses leçons au Collège de France. Quel est l’apport de cette lecture et en quoi permet-elle de poser un regard différent sur la question de la régulation de l’audiovisuel ?
SD: L’historicisation de la dichotomie public-privé est elle-même profondément foucaldienne, notamment dans la manière dont la critique de la «gouvernementalité» a été reprise dans le travail de l’«école anglophone» des Foucaldiens, comme Nik Rose. Je suis venu à Foucault pour de nombreuses raisons. Dans la littérature secondaire sur la citoyenneté, la consommation, la sphère publique et le néolibéralisme, il y a souvent les débats théoriques entre les adeptes d’une approche foucaldienne et ceux plus proches de Gramsci ou d’Habermas, par exemple. D’un point de vue méthodologique également, j’ai commencé à utiliser l’analyse critique du discours (ACD), mais j’ai finalement trouvé que l’analyse archéologique et généalogique foucaldienne était plus utile pour l’étude archivistique à long terme et plus convaincante pour interpréter un large corpus de textes que l’approche marxiste générale qui essaie d’identifier les distorsions idéologiques. Mais je ne rejette pas les perspectives gramsciennes ou habermassiennes ; je m’intéresse plutôt à l’utilisation de perspectives multiples pour combler les lacunes qui apparaissent lorsqu’on privilégie une seule approche (théorique ou méthodologique).
En termes de (néo)libéralisme, le travail de Foucault est particulièrement important : en particulier, ses conférences sur le libéralisme (publiées sous le titre Sécurité, Territoire, Population) et le néolibéralisme (Naissance de la biopolitique). Le terme «néolibéralisme» a tendance à être utilisé dans beaucoup d’études anglophones sur la politique des médias (et dans beaucoup d’autres domaines) comme étant à peine plus qu’un raccourci pour tout ce qui ne va pas dans le monde. Dans d’autres disciplines cependant (notamment les études urbaines et la géographie), il y a eu une longue succession de débats sur la façon de comprendre le néolibéralisme, de s’intéresser à son histoire et de croiser des approches théoriques et méthodologiques plurielles pour le critiquer. Une grande partie de ce travail a bénéficié d’une lecture critique des conférences de Foucault (à l’origine inédites) sur le sujet. Une fois que vous les avez lues, vous ne pouvez plus continuer à utiliser le terme de façon désinvolte ; et si vous ne les avez pas lues, alors vous devriez peut-être l’utiliser avec prudence. Il existe maintenant des revues dans d’autres disciplines qui rejettent systématiquement tout article qui utilise ce terme sans reconnaître ce qu’il signifie et quelle approche est utilisée pour l’analyser. Plus globalement, je ne pense pas que le réductionnisme soit quelque chose de particulièrement fructueux dans les études sur l’audiovisuel.
Plus que le simple respect des standards de rigueur académique, c’est vraiment important parce que cela nous aide à comprendre ce qui se passe réellement dans le domaine de la radiodiffusion. La «néolibéralisation» de l’audiovisuel a été un processus de longue durée, avec des lobbyistes et d’autres personnes influant sur les débats en matière de régulation bien avant le tournant néolibéral évident des années 1980. Et cela nous aide à comprendre que le néolibéralisme ne concerne pas seulement la privatisation et la déréglementation de la radiotélévision de service public, mais aussi la re-réglementation de la radiodiffusion en termes de marché et de mécanismes concurrentiels. Ce n’est pas la même chose que le libéralisme classique du laisser-faire (la philosophie de la «liberté de la presse»). Il s’agit de concurrence, pas d’échange. Il s’agit de contrats plutôt que de droits de propriété. Ce n’est pas toujours facile à expliquer en termes d’idéologie, et certainement pas toujours en termes d’intérêts privés ou, selon une approche typiquement marxiste, de transfert de pouvoir à une classe d’élites (bien que cela puisse souvent être le cas). Il nous aide donc à comprendre que, bien qu’il serve les intérêts des citoyens et des consommateurs, l’Ofcom (l’organisme britannique de régulation des télécommunications), est l’incarnation même de la réglementation néolibérale.
FV: Dans la plupart des pays européens, les années 1970 apparaissent comme un tournant avec la reconsidération des monopoles sous la pression notamment de la nouvelle donne technique mais aussi de la mobilisation d’acteurs privés et médiatiques pour infléchir les principes de régulation. En Grande-Bretagne, le rapport Annan (1977) incarne cette évolution en affichant une position plus ouverte envers la publicité et en substituant le consensus autour de l’intérêt public par le principe du pluralisme. Au-delà des membres du comité Annan lui-même, quels sont les acteurs sociaux qui ont œuvré à cette reconfiguration ?
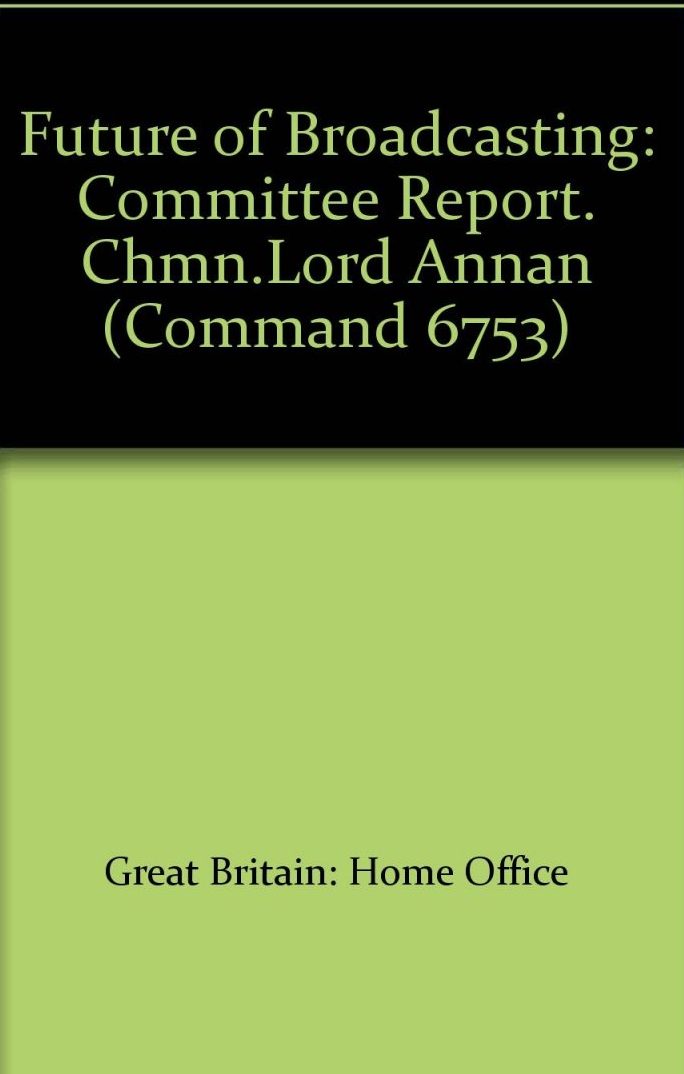
SD: Oui, c’est tout à fait le contexte du rapport Annan et du Royaume-Uni des années 1970. Mais dans ce cas-ci, c’était aussi une période où l’alternance politique était de mise entre le parti travailliste et le parti conservateur, ce qui a eu pour conséquence que l’enquête avait été arrêtée et recommencée plusieurs fois. En ce qui concerne ceux qui ont influencé l’enquête et la décision d’ouvrir celle-ci, ceux qui sont à gauche du Parti travailliste (comme Tony Benn), les universitaires impliqués dans des groupes comme le Groupe 76, la Conférence permanente sur la radiodiffusion et le Glasgow University Media Group, ainsi que divers syndicats et groupes de pression affiliés, ont été particulièrement actifs. Comme l’ont montré des universitaires comme Des Freedman (2001), le rapport était un juste compromis entre leurs appels radicaux à la réforme (qui comprenaient l’élimination des radiodiffuseurs existants) et les propositions plus conservatrices des radiodiffuseurs eux-mêmes.
Outre les critiques du pouvoir politique des radiodiffuseurs et de la couverture par la BBC des conflits du travail en particulier, Annan réagissait également à une certaine «crise de représentation» de la société britannique, le rapport reconnaissant celle-ci comme une «formation sociale fracturée» et diverse, plutôt qu’un public universel et homogène de sujets impériaux ; le pluralisme allait donc de pair avec la diversité (culturelle). Comme Graham Murdock (un des pionniers des Television studies et de l’économie politique de l’audiovisuel) l’a fait valoir il y a de nombreuses années, cela a eu pour conséquence que la nouvelle chaîne de télévision créée par le rapport – Channel Four – comprenait une contradiction fondamentale. Elle était en effet chargée de représenter les voix des minorités et les questions auxquelles ni le marché ni la BBC ne parvenaient à répondre, tout en dépendant (quoique indirectement au début) des recettes publicitaires et donc des incitations commerciales.
La reconnaissance de l’hostilité du public à l’égard du monopole (double monopole en fait dans la situation britannique depuis la création d’ITV en 1955) d’une part, des différences culturelles entre les citoyens d’autre part, justifiait l’émergence du «choix» comme nouveau principe directeur de la régulation, compliquant ce qui était jusqu’alors une distinction raisonnablement claire entre ce qui était «public» et ce qui était «privé». Cela dit, le rapport maintient néanmoins une distinction claire entre les «intérêts des consommateurs» et l’«intérêt public», les premiers n’étant abordés que sur une page d’un rapport qui en compte 522.
FV: Une autre borne est constituée par le rapport Peacock de 1986. Dans la littérature secondaire, il est souvent vu comme l’emblème d’une forme de thatchérisme et l’émergence du tournant néolibéral. Ton analyse est plus nuancée et pourtant comment contester la recrudescence des logiques économiques et managériales depuis ce moment ?
SD: Certes, il suffit de jeter un coup d’œil aux divers rapports pour constater un clair changement de ton. Le Rapport Peacock a été rédigé par les mêmes économistes qui avaient fait partie du mouvement néolibéral de réflexion des décennies précédentes, et ils avaient été mandatés par Margaret Thatcher. Mais comme le reconnaissent tous les spécialistes des médias (voir par exemple O’Malley & Jones, 2009), Peacock n’a pas fait ce que Thatcher espérait, et dans son évaluation économique de la radiotélévision de service public, il a conclu que même si la redevance n’était pas aussi positive qu’un marché libre, elle était meilleure qu’un système financé par la publicité ; il a donc proposé que le statu quo soit maintenu (au moins dans le court terme). Il n’y a pas eu d’autres rapports depuis (ils avaient été publiés à peu près tous les dix ans jusque-là), et il est vrai qu’il a changé le langage et l’orientation du débat réglementaire.
Mais à trop se focaliser sur le caractère néolibéral du rapport Peacock, on néglige son engagement impartial et nuancé sur certaines questions. Et aucun document n’a développé ce caractère nuancé depuis. Le rapport Hunt sur la radiodiffusion par câble fait passer le rapport Peacock pour le Manifeste du parti communiste ! L’accent mis par Peacock sur la «souveraineté des consommateurs», par exemple, représentait en fait une forme de troisième voie par rapport à la redevance et au financement par la publicité. Bien que la critique ait eu tendance à se concentrer sur l’absence ou la marginalisation des intérêts des citoyens ou du service public depuis Peacock, il est important de reconnaître que la souveraineté des consommateurs n’a pas été beaucoup considérée non plus. Au contraire, la liberté de choix du consommateur a été tenue pour synonyme de concurrence (et donc contraire au service public). Et par rapport aux rapports précédents, bien que je convienne bien sûr qu’ils privilégient davantage l’importance sociale de la radiodiffusion, il faut aussi reconnaître que nulle part l’idée d’un public actif n’est autant mise en avant qu’au sein du rapport Peacock.
Une façon d’aller de l’avant serait que les réformateurs se réapproprient la souveraineté des consommateurs des néolibéraux et l’utilisent pour plaider en faveur d’un média public qui privilégie l’influence et la participation active du public.
L’émission Newsnight sur BBC-2 analyse la sortie du rapport Peacock, le 29 mai 1986
FV: Aujourd’hui le service public semble fragilisé un peu partout en Europe, même si le résultat de la votation suisse contre l’initiative No Billag montre que le principe de la liberté du consommateur n’a pas annihilé les principes d’universalité et d’indépendance qui restent au cœur d’une des déclinaisons du service public. En Grande-Bretagne, l’actualité récente a été marquée par différents rapports sur le futur de la BBC. Quelles en sont les grandes tendances et comment vois-tu l’évolution de ce débat dans les mois et années à venir ?
SD: Récemment, l’influence du gouvernement sur la gestion quotidienne de la BBC a ranimé de nombreuses craintes, et les documents récents produits par le gouvernement conservateur ont souligné que le rôle de la BBC doit être un rôle de «distinction», un nouveau terme qui renvoie à la nécessaire correction de la défaillance du marché (il faut donc que la BBC fasse que ce que les autres chaînes ne feront pas). Un autre avenir pour les «médias publics» pourrait être de démocratiser la BBC en faisant participer le public à l’élection du conseil d’administration, et en faisant participer les employés à l’élection du directeur général, plutôt que de laisser au gouvernement le soin de les nommer. Comme indiqué précédemment, l’organisme de régulation de la radiotélévision de service public devrait également être indépendant et faire participer davantage le public, tandis que les points de vue des groupes BAME (minorités noires et ethniques) devraient être clairement pris en compte dans le cadre de cette participation publique. La Media Reform Coalition, actuellement dirigée par Natalie Fenton, et maintenant le Parti travailliste de Jeremy Corbyn, ont récemment proposé de telles mesures, tandis que des écrivains comme Tom Mills (2016) et Dan Hind (2012) ont également proposé un rôle plus actif pour le public dans la commande des programmes. Si les travaillistes gagnent les prochaines élections, il pourrait y avoir de grands changements.
L’approche de la BBC en matière d’impartialité et d’équilibre soulève également des questions plus spécifiques et plus urgentes. L’approche actuelle qui consiste à suivre la ligne éditoriale des tabloïds, à donner aux extrémistes de droite et aux négationnistes du changement climatique une plate-forme d’expression de manière peu légitime, ainsi qu’à ne pas contester ou nuancer les affirmations litigieuses, signifie que la BBC risque de devenir avant tout un problème pour la démocratie.
Mettre l’accent sur l’indépendance et le caractère public de l’espace médiatique est évidemment important, mais cela ne nous permet pas d’aller bien loin. Pour construire le type de «médias publics» que nous voulons vraiment, nous devons repenser et préciser ce que nous entendons par «public», et évaluer de manière critique les défaillances des modèles antérieurs comme actuels.
Références
Born, G (2005) Uncertain Vision: Birt, Dyke and the Reinvention of the BBC, London: Vintage
Freedman, D (2001) ‘What use is a public inquiry? Labour and the 1977 Annan Committee on the Future of Broadcasting’, Volume: 23, issue: 2, page(s): 195-211
Hind, D (2012) The Return of the Public: Democracy, Power and the Case for Media Reform, London: Verso.
Mills, T (2016) The BBC: The Myth of a Public Service, London: Verso.
O’Malley, T, and Janet Jones (eds.) (2009) The Peacock Committee and UK Broadcasting Policy, Hampshire: Palgrave Macmillan.
Pour en savoir plus sur le travail de Simon Dawes, nous renvoyons à son très intéressant blog, et pour en savoir plus sur les débats sur les médias britanniques, au site de la Media Reform Coalition