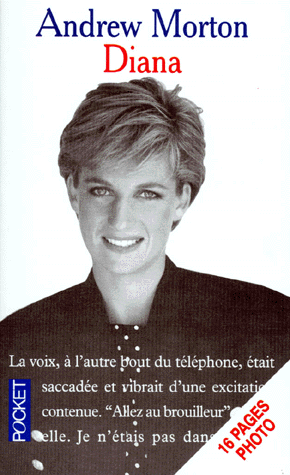Pour en finir avec le jeu des sept erreurs historiques
Comment expliquer la polémique autour de la dernière saison de The Crown ? Pourquoi chercher à distinguer le faux du vrai alors que toute fiction audiovisuelle à univers historique consiste à réécrire l’histoire en des termes (un langage, une esthétique, une mise scène) qui lui sont propres ? Pourquoi faire, dans ce cas précis, le procès de la fictionnalisation de l’histoire ?
Par Mireille Berton, Section d’histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne, décembre 2020.

Tous les médias en parlent. Télérama, dans un article du 3 décembre 2020, promet d’expliquer pourquoi « la polémique vire (presque) à l’affaire d’État en Angleterre ». Interrogé dans un reportage du 19h30 (RTS), un journaliste de l’Illustré « estime qu’il faudrait signaler clairement au début de chaque épisode qu’il s’agit d’une fiction », à l’instar du ministre britannique de la Culture – une demande qui en dit long sur la méfiance endémique vis-à-vis des effets de réel attachés à l’image audiovisuelle. Avec leur ouvrage The Crown, le vrai du faux. La série culte décryptée (Gründ, 2020), trois journalistes proposent quant à eux de « fact-checker l’histoire de la famille royale d’Angleterre » afin de confirmer l’évidence : si certains détails sont inventés, l’ensemble est « vrai ». Et pour cause : la série s’inscrit dans une longue tradition de fictions sur la monarchie historique, comme le rappelle Ioanis Deroide.
Alors pourquoi une telle agitation autour de cette série, et en particulier de sa quatrième saison, au-delà de l’argument de la fascination pour la famille royale britannique qui constitue, de facto, un sujet sensible[1] ?
Le problème de cette quatrième saison n’est pas tant qu’elle aborde l’histoire récente, qu’elle mette en scène des personnalités encore vivantes ou encore qu’elle soit coupable de micro-écarts avec l’histoire, des entorses dont toutes les fictions à univers historiques sont coutumières car elles sont nécessaires à l’efficacité narrative[2]. Le problème, c’est d’abord qu’elle nous raconte un fragment de l’histoire de la famille royale que nous connaissons déjà fort bien, à savoir le mariage entre le prince Charles de Galles et Lady Diana. Ce nouveau volet livre en effet une histoire familière, maintes fois décrite dans la presse people et des documentaires et surtout véhiculée par l’une de ses protagonistes, Lady Di elle-même, qui s’est confiée à un journaliste, Andrew Morton, auteur de sa biographie autorisée Diana, sa vraie histoire (1992).
Raconter l’histoire de Diana par Diana
C’est pourquoi, au lieu de se demander si la série trahit la « vérité » historique (en soit inatteignable dans l’absolu), il conviendrait de se demander pourquoi l’équipe de production choisit de reproduire cette version de l’histoire où Lady Di est dépeinte comme la victime expiatoire de la famille royale qui l’aurait instrumentalisée à son profit. Cette question me paraît en effet plus pertinente que de se demander si elle lègue une vision déformée de l’histoire récente aux jeunes générations (on devrait plutôt se soucier que celles-ci connaissent l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de la colonisation… ).
La série s’emploie en effet à déconstruire, pour la énième fois, le conte de fées auquel les Britanniques ont cru dès l’entrée en scène de Diana dans l’histoire de la famille royale, en présentant la princesse comme un personnage tragique digne des plus grands romans et pièces de théâtre : elle est belle, romantique, naïve, tourmentée, fragile, et surtout sacrifiée. Elle a donc toutes les qualités pour faire un excellent personnage de fiction. Quel est donc l’intérêt d’alimenter, encore aujourd’hui, une telle hagiographie ?
J’y vois plusieurs raisons, dont la première est certainement la plus spéculative et dispensable : la série prend le parti de Diana dans l’espoir de favoriser le couronnement du prince Williams au détriment de Charles dont la cote de popularité est déjà bien basse. En ce sens, The Crown participerait à soutenir (à titre posthume) le souhait de Diana de voir son fils remplacer un homme considéré comme la source de tous ses tourments. Mais laissons ces conjectures à la presse grand public et aux spécialistes de la couronne, et tentons de répondre avec le regard que nous offre la perspective historienne. Si la saison 4 raconte l’histoire de la famille royale entre 1980 et 1990 du point de vue de Lady Di, c’est parce qu’il existe un matériau qui a été fourni par la princesse elle-même, alors que le prince Charles n’a jamais enfreint le protocole en se confiant sur sa vie privée. Il est donc logique que l’on reconstruise l’histoire à partir des sources à disposition.
Or, adhérer au point de vue de Diana a des conséquences sur la manière de raconter l’histoire qui glisse imperceptiblement vers le sensationnel, le personnel, l’intime[3]. De fait, on constate à regret que cette nouvelle saison nous plonge davantage dans la complexité d’une histoire individuelle que dans une histoire collective. Tandis que toute fiction historique invite à un voyage dans le temps au cours duquel on apprend des choses tout en se divertissant, ici la fonction ludique semble privilégiée au détriment de la fonction didactique, nous entraînant ainsi dans les affres de la mythologie qui s’est cristallisée autour de Lady Di – une mythologie certes tragique, mais dépourvue des enjeux politiques qui sous-tendaient les premières saisons. Au demeurant, on peut déplorer que cette saison n’aborde pas davantage les tensions sociales et politiques internes au pays, hormis au cours des rares épisodes qui évoquent les actions de l’IRA et la crise économique touchant de plein fouet les classes laborieuses (incarnées à travers le personnage de Michael Fagan). Bien que thématisés, ces aspects sont en grande partie éclipsés par l’arc narratif de Lady Diana centré sur ses déboires personnels.
La contradiction du jeu des (sept) erreurs historiques
Au problème du biais fictionnalisant intrinsèque au « mythe » de Lady Di, s’ajoute le malentendu autour du statut des fictions à univers historiques, comme en attestent les nombreux articles qui s’interrogent sur le degré de « réalisme » de la série via de multiples jeux des sept erreurs auquel se prête, par exemple, Stéphane Bern pour Paris Match. La confusion relative à la « véracité » de la fiction est, au surplus, entretenue par le créateur de la série, Peter Morgan, qui revendique à la fois un droit à l’invention et une grande proximité avec l’histoire. Dans cette saison, l’effort de reconstitution historique concerne en particulier la garde-robe de Lady Diana dont « 20 tenues iconiques » auraient été reproduites quasiment à l’identique.
D’un côté, donc, la production clame son innocence face aux accusations de mystification, de l’autre elle reconstitue scrupuleusement des détails vestimentaires qui auraient tout aussi bien être extrapolés (mais cela témoigne aussi de la ténacité d’une icône populaire). Facile en ces circonstances d’être victimes du jeu des (sept) erreurs en cherchant à distinguer le vrai du faux – des catégories qui ne font aucun sens pour appréhender des séries télévisées et des films, qu’ils relèvent du documentaire ou de la fiction, car il n’existe pas de degré zéro de la représentation.
Au lieu d’insister lourdement sur la boulimie de Lady Diana en rappelant au public qu’il ne faut en aucun cas suivre son exemple (alors même qu’elle a été un modèle pour toute une génération de femmes), la série aurait pu se focaliser davantage sur la question de l’affaiblissement de la couronne britannique, phénomène important pour comprendre aujourd’hui le Brexit ; tout comme on aurait pu souhaiter qu’elle propose une vision un peu plus nuancée du mariage princier. Quoiqu’il en soit, force est de constater que le triangle amoureux formé autour du prince Charles fait dériver la série vers le soap opera, les toilettes raffinées de Diana et ses problèmes de santé détournant l’attention de ce qui constitue l’intérêt principal de cette série : retracer le destin extraordinaire d’une femme, Elisabeth II, et ses relations contrastées au pouvoir.

Le problème donc de cette saison, ce ne sont pas tant les entorses à l’histoire qui peuvent être nécessaires pour encourager l’adhésion du public[4] ; c’est d’entretenir l’ambiguïté, en occultant le biais fictionnel qui sous-tend un récit façonné en grande partie par la légende de Lady Di, laquelle découle, j’insiste là-dessus, d’une réécriture de l’histoire. Car tel est, disait Paul Ricoeur, le propre de l’écriture historienne que de construire un récit à partir de sources partielles, partiales et contradictoires d’un fait. C’est pourquoi, en constatant que la série a inventé certains faits, les spectateurs·trices peuvent avoir l’impression d’avoir été trahi·e·s – alors même que les fictions historiques sont d’abord un point de vue sur l’histoire. À preuve, la série exemplaire d’ouvrages publiés chez Georg par la Maison de l’Histoire de l’Université de Genève à laquelle nous devrions toutes et tous revenir : les séries à univers historiques ne sont pas l’histoire elle-même qui ne se dévoile jamais d’emblée telle quelle dans sa limpide « vérité » ; elles donnent toujours à découvrir l’histoire à travers un regard qui en saisit des fragments et les met en scène selon un langage et une esthétique qui leur sont propres.
Un regard contemporain sur le passé
À sa décharge, The Crown poursuit l’un de ses objectifs qui consiste à valoriser les personnages féminins – y compris Margaret Thatcher – au détriment des personnages masculins. La série développe en effet un discours passionnant sur le rôle de personnalités féminines qui ont marqué durablement l’histoire d’Angleterre (bien que pour des raisons totalement différentes). Sous cet angle, elle pose un regard contemporain sur le passé, à savoir un regard conscient de la place des femmes dans des milieux largement dominés par les hommes, et des difficultés qu’elles rencontrent lorsqu’elles défient les normes sociales. The Crown explicite ainsi, à sa manière, l’idée que toute fiction historique est forcément ancrée dans le présent de l’époque de production, et qu’il n’est plus possible aujourd’hui d’imaginer une fiction sans personnages féminins en position d’agentivité.
Plutôt que d’appréhender l’histoire sous l’angle d’une suite d’événements justes ou faux, il s’avère plus productif de comprendre quel est le point de vue à partir duquel on la raconte, les entorses à l’histoire n’invalidant pas pour autant leur valeur en tant que discours sur l’histoire.

Non, la fiction ne remplacera jamais l’histoire puisque les séries à univers historique visent avant tout la vraisemblance des personnages, des comportements, des décors, etc. – donc une certaine cohérence et authenticité d’ensemble. Surtout, l’image audiovisuelle permet d’enrichir notre connaissance du passé à travers une histoire vivante qui dépend en grande partie de détails conférant une matérialité, une densité et une richesse au récit. Comme l’observe à juste titre Ioanis Deroide, le but des fictions historiques n’est pas de reproduire parfaitement un fait historique avéré, mais d’être convaincantes visuellement, de manière à entraîner une immersion « sensorielle » dans l’histoire ; et c’est à ce titre qu’elles proposent une histoire complémentaire aux manuels scolaires et aux ouvrages académiques.
Cette polémique autour de The Crown aura ainsi, du moins je l’espère, l’avantage d’indiquer la nécessité de s’interroger non pas sur les écarts pris par la fiction vis-à-vis de la « réalité » historique, mais sur les raisons qui motivent ces écarts, en ce qu’ils questionnent la manière de mettre en récit, en scène et en image l’histoire.
Notes:
[1] La série a toujours pris des libertés avec l’histoire, mais ce qui change avec cette saison, c’est probablement qu’elles touchent à un point très sensible de l’histoire de la famille royale, à savoir Lady Di, une icône extrêmement populaire qui imprègne encore l’imaginaire collectif. L’agitation autour de la série est donc à la mesure des affects investis par le public dans la légende de Lady Diana.
[2] Les « affabulations » historiques n’ont pas pour but de tromper, mais de servir la vraisemblance du récit, de faciliter la compréhension globale d’une époque peu familière, de faire l’économie d’une longue mise en contexte, de rendre attrayante des aspects « austères » de l’histoire politique, etc.
[3] Comme le montre le fait que les journalistes se demandent si Lady Di a bien fait du patin à roulettes dans Buckingham Palace.
[4] On se demande par exemple jusqu’à quel point Margaret Thatcher a été en porte-à-faux avec la famille royale, comme l’indiquent ses visites à Balmoral. Mais si la série exacerbe les différences entre elle et la reine, c’est pour mieux renforcer la tension dramatique qui se dégage de leur dernière rencontre. Celle-ci révèle en effet qu’elles ont beaucoup en commun, à commencer par leur rôle stratégique dans la sphère publique, laquelle est d’habitude l’apanage des hommes.
Pour aller plus loin:
Mireille Berton était invitée au 19H30 de la RTS le 29 novembre 2020. Écouter son intervention.